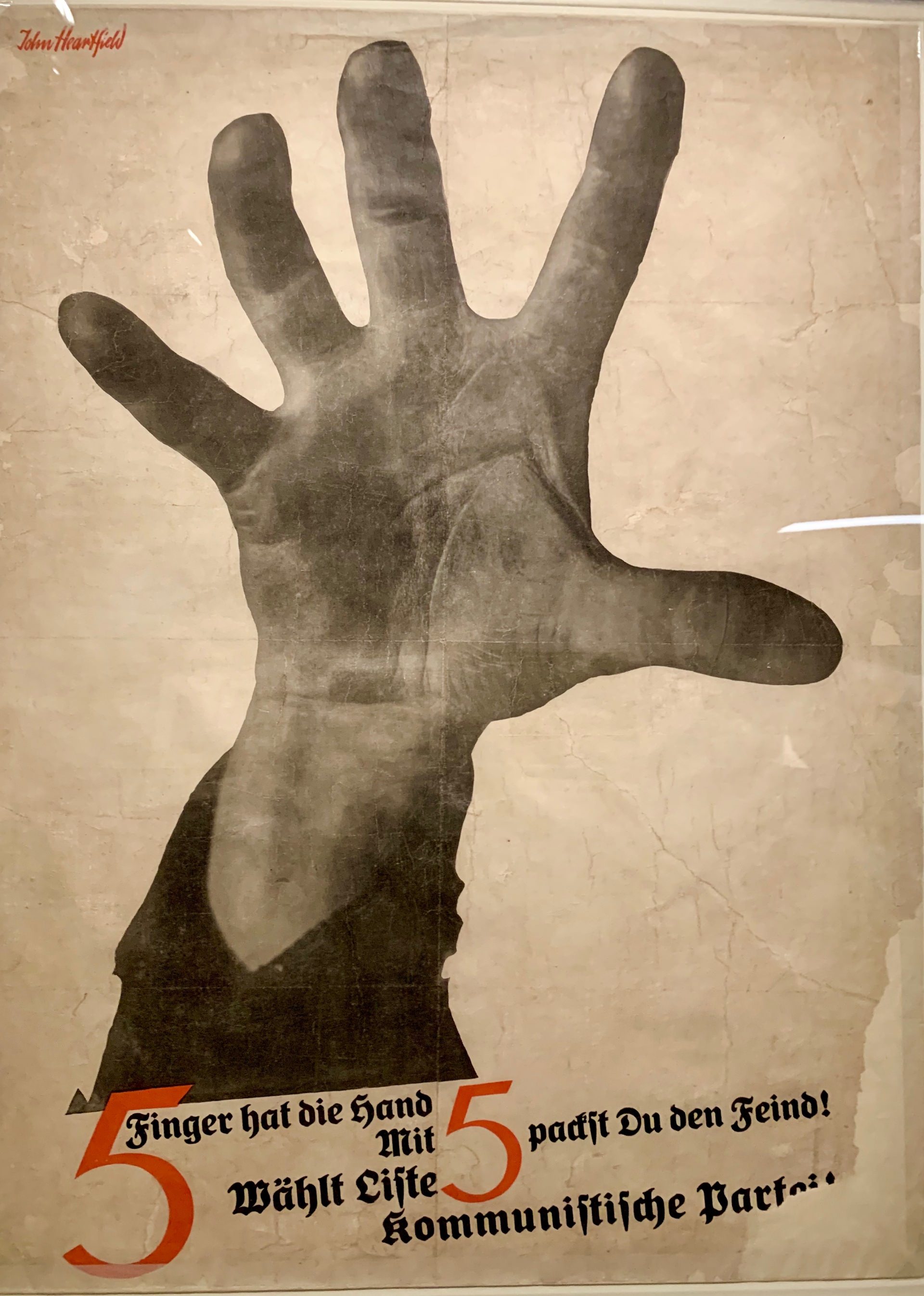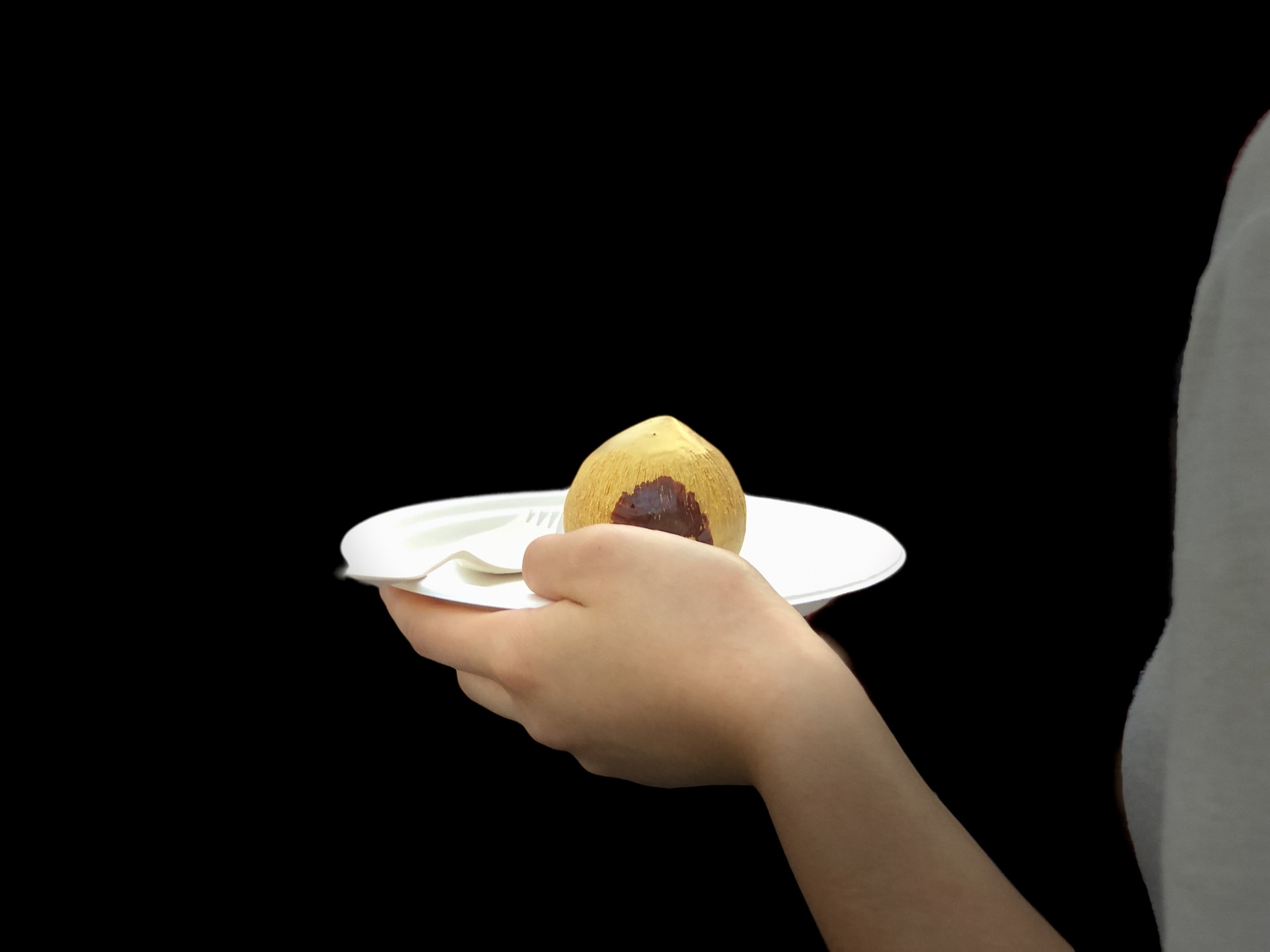La créativité (notre vertu) est un concept qui pousse expressément à l’équivoque : différents principes et valeurs en motivent les diverses définitions possibles. Les mots, qui servent à diviser et à détruire, à créer et à composer, ce qui compte c’est l’approche. Et surtout en cuisine. Dis-moi ce que tu manges et je te dirai qui tu es, écrivait Jean Anthelme Brillat-Savarin, grand physiologiste du goût ; nous pouvons également y ajouter « comment tu manges », et nous aurions le portrait de deux des plus extraordinaires cultures alimentaires et gastronomiques de la planète, la culture italienne et la culture française. La cuisine italienne est une cuisine de la résilience, du partage et est obsédée par la tradition, alors qu’on trouve en France une cuisine de la composition, du rituel, de l’expérience à table. L’expérience française de la table est codifiée tout comme chaque élément du corps gastronomique. Formules déjeuner, cartes et menus sont imprescriptibles pour quiconque mette les pieds à Paris, en France et même partout (hôtels, bateaux de croisière, parcs d’attractions), la cuisine française coincide avec la cuisine contemporaine, c’est à dire internationale. En Italie nous avons i primi, un patrimoine national mais nous arrivons seconds quand il s’agit de raconter (le storytelling) le trésor que la nature et la culture nous ont offert pendant des siècles. Nous sommes esclaves de pizzas et des pâtes, comme les Français le sont du goût à tout prix. Ils sont abondamment gâtés par le terroir (champignons, foie gras, huitres fines de claire), alors que chez nous, c’est le territoire qui domine les rituels, avec ses produits simples et du quotidien (qui n’en sont pourtant pas moins rares), de la pasta con la mollica au sicchio d”a munnezza vésuvien, composé des fruits secs (raisins secs, noix, pignons) récupérés de la table de Noël de la veille. Aliments d’une rare bonté et à la consistance singulière, très éloignés de l’âge d’or d’Auguste Escoffier, inventeur à la fin du XIXe siècle de la cuisine gourmande, de la gastronomie française (et italienne). Les techniques, les matières, les cuissons, sont définies par le premier chef national français, dont les considérations ne seront plus jamais abandonnées. Le nouveau paradigme repose sur 3 concepts : la cuisine est de la haute couture, art révolutionnaire et nouveau de la bourgeoisie (désormais les têtes de la noblesse sont tombées depuis plus d’un siècle), cuisiner est un métier qui requiert la connaissance exacte de la physique, de la chimie et qui est axé sur le goût, mettant en exergue tous les sens (en premier l’odorat). La quatrième règle, qui n’est pas écrite noir sur blanc mais qui a été récemment énoncée par l’Unesco, concerne le lieu où l’on en jouit, la façon privilégiée avec laquelle nous la consommons : la cuisine est servie à table, autour d’un rituel qui prend le nom de repas gastronomique. Dès la première page de la bible de la nouvelle cuisine internationale, nous retrouvons, le modèle déjà confectionné de la nouvelle cuisine (auquel vient s’ajouter ensuite la nécessité de simplifier et de rendre leur dignité aux matières premières, au terroir). Au delà des Alpes, le même discours se renouvelle : la cuisine se fait à la maison, se déguste (même) dans la rue, on y ajoute ou pas de la noix de muscade (Artusi) ou de l’huile si besoin (Donpasta), en fonction de son appétit, de son humeur. Ou juste histoire de, sans aucune raison apparente. D’abord à Florence puis à Naples, toutes deux capitales d’une cuisine syncrétique aristocratique-populaire, on expérimente depuis des siècles le long des tablées aristocratiques décadentes et somptueuses, mais on consent à un fleuve souterrain qu’est celui des cuisines populaires communautaires, à s’exprimer, à entrer dans les cuisines, pas seulement dans celle du roi. Aujourd’hui, les rennes des deux premières cuisines nationales du monde (la nôtre répondant au principe de l’indétermination, la leur aux lois de la force centrifuge) son tenues d’un côté par Massimo Bottura (qui, et ce n’est pas un hasard, cuisine dans une Osteria), et de l’autre, par Alain Ducasse (qui a carrément investit le Château de Versailles). Ces derniers ne se demandent pas tant ce que serait et comment serait une cuisine humaniste et populaire enfin unie à la cuisine illuministe, d’ailleurs assez bourgeoise. Quelque chose qui ressemble à une nouvelle révolution, dont nous commençons peut être à flairer l’épiphanie. Dans l’attente de la prochaine, inévitable, restauration.